

Un conte de fées. C'est le terme qui résume l'oeuvre du réalisateur de Roméo+Juliette.
Gatsby le Magnifique. Entre lumières aveuglantes, couleurs éclatantes et château féérique, Baz Luhrmann a réussi ce que Jack Clayton avait raté, en 1974.
Le film pourrait être une suite parfaite du roman de Maupassant : Bel-Ami. Un Bel-Ami amoureux, riche et empli de gloire. Mais comme le prince de Paris, Gatsby demeure seul, sans ami, et toujours avide de richesse. Pour lui, il faut « toujours aller plus haut ». Seulement, à la différence de Georges Duroy, Jay Gatsby agit par amour. Et c'est cet amour qui le maintient en vie, l'anime d'une passion folle et sans limite.
Luhrmann annonce le ton dès le début du film avec une bande-son qui restera dans les annales. Le spectateur suit, aux côtés de Tobey Maguire, le personnage si étrange de ce milliardaire reclus dans cette demeure tirée tout droit de contes pour enfants. En sus, les XX, Jay-Z ou encore Florence and The Machine accentuent la cadence. Vous dites cadence ? Oui, cette cadence, cette rapidité, cet enchainement de scènes qui s'aligne parfaitement à ces années de liberté qu'étaient les années 30.
Pour les néophytes de l'oeuvre de Fitzgerald, Gatsby n'est pas le jeune riche issu d'une lignée WASP. Non, Gatsby est un prince devenu grenouille, un homme qui ne jure que par un seul et même mot : l'espoir. L'espoir de retrouver celle qu'il aime. Cette femme, habilement jouée par Carrey Mulligan, illustre la douceur et la naïveté de ces hommes et femmes qui vécurent entre les deux guerres. Un espoir donc, un espoir qui anime le personnage de Leonardo Di Caprio, magistral, nous confirmant son statut d'acteur aussi à l'aise en chef de plantation de coton sadique, qu'en mystérieux riche festoyant chaque chaude soirée d'été new-yorkaise.
Le rôle de Tobey Maguire, Nick Carraway, n'est pas un personnage omniscient mais bien un spectateur. Un spectateur qui nous permet d'entrer dans le film, de se téléporter dans le New-York de Lucky Luciano, et de ne plus être dans une salle obscure assis sur des fauteuils inconfortables. L'odeur des cigares, le bruit des glaçons : tout est là. On ne pense plus à ce jour funeste où la France est entrée en récession. Voguant dans Mulberry Street, on croise à l'angle d'une rue un homme en costume trois-pièces, « Do you know Gatsby ? ». Dès lors, on embarque dans un rythme effréné, s'invitant à ces soirées mondaines, mais en ne sachant pas qui est Gatsby.
Car oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est un conte de fées. Et que serait un conte de fées sans morale ? Le spectateur n'est plus, le personnage est là. Et plus nous avançons dans l'histoire, plus nous découvrons Gatsby. Le film nous transporte dans une extase : whisky, Lucky Strike et musique. Mais la morale arrive, et elle s'impose : nous demeurerons seuls. L'argent, la gloire et... rien d'autre. Gatsby possède tout cela. Mais Baz Luhrmann, et surtout Fitzgerald, nous amène, nous spectateurs devenus personnages, à nous interroger sur notre condition : nous restons seuls, certes, mais comme vous pourrez l'apercevoir : « Ad Finem Fidelis ».
Gatsby le Magnifique. Entre lumières aveuglantes, couleurs éclatantes et château féérique, Baz Luhrmann a réussi ce que Jack Clayton avait raté, en 1974.
Le film pourrait être une suite parfaite du roman de Maupassant : Bel-Ami. Un Bel-Ami amoureux, riche et empli de gloire. Mais comme le prince de Paris, Gatsby demeure seul, sans ami, et toujours avide de richesse. Pour lui, il faut « toujours aller plus haut ». Seulement, à la différence de Georges Duroy, Jay Gatsby agit par amour. Et c'est cet amour qui le maintient en vie, l'anime d'une passion folle et sans limite.
Luhrmann annonce le ton dès le début du film avec une bande-son qui restera dans les annales. Le spectateur suit, aux côtés de Tobey Maguire, le personnage si étrange de ce milliardaire reclus dans cette demeure tirée tout droit de contes pour enfants. En sus, les XX, Jay-Z ou encore Florence and The Machine accentuent la cadence. Vous dites cadence ? Oui, cette cadence, cette rapidité, cet enchainement de scènes qui s'aligne parfaitement à ces années de liberté qu'étaient les années 30.
Pour les néophytes de l'oeuvre de Fitzgerald, Gatsby n'est pas le jeune riche issu d'une lignée WASP. Non, Gatsby est un prince devenu grenouille, un homme qui ne jure que par un seul et même mot : l'espoir. L'espoir de retrouver celle qu'il aime. Cette femme, habilement jouée par Carrey Mulligan, illustre la douceur et la naïveté de ces hommes et femmes qui vécurent entre les deux guerres. Un espoir donc, un espoir qui anime le personnage de Leonardo Di Caprio, magistral, nous confirmant son statut d'acteur aussi à l'aise en chef de plantation de coton sadique, qu'en mystérieux riche festoyant chaque chaude soirée d'été new-yorkaise.
Le rôle de Tobey Maguire, Nick Carraway, n'est pas un personnage omniscient mais bien un spectateur. Un spectateur qui nous permet d'entrer dans le film, de se téléporter dans le New-York de Lucky Luciano, et de ne plus être dans une salle obscure assis sur des fauteuils inconfortables. L'odeur des cigares, le bruit des glaçons : tout est là. On ne pense plus à ce jour funeste où la France est entrée en récession. Voguant dans Mulberry Street, on croise à l'angle d'une rue un homme en costume trois-pièces, « Do you know Gatsby ? ». Dès lors, on embarque dans un rythme effréné, s'invitant à ces soirées mondaines, mais en ne sachant pas qui est Gatsby.
Car oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est un conte de fées. Et que serait un conte de fées sans morale ? Le spectateur n'est plus, le personnage est là. Et plus nous avançons dans l'histoire, plus nous découvrons Gatsby. Le film nous transporte dans une extase : whisky, Lucky Strike et musique. Mais la morale arrive, et elle s'impose : nous demeurerons seuls. L'argent, la gloire et... rien d'autre. Gatsby possède tout cela. Mais Baz Luhrmann, et surtout Fitzgerald, nous amène, nous spectateurs devenus personnages, à nous interroger sur notre condition : nous restons seuls, certes, mais comme vous pourrez l'apercevoir : « Ad Finem Fidelis ».
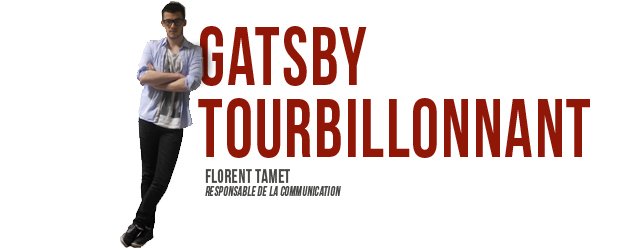
Le pari était osé.
Gatsby est un monument, une institution, une référence entre toutes de la littérature américaine du XXe siècle. Chacune de ses adaptations est un exercice délicat. La première, portée à l’écran par Jack Clayton en 1974, se voulait en totale adéquation avec l’esprit du roman de Fitzgerald. La plupart des puristes avait été comblée, faisant pourtant fi du manque de saveur général qui accompagne le déroulé sans relief de l’histoire. L’époque y est peut-être pour beaucoup. Cela dit, la pression était grande pour cette nouvelle adaptation.
Véritable tourbillon de flamboyance, le film de Luhrmann est un parti pris qui ne fait que peu de concessions à la pression de l’héritage. Dès les premiers plans, on nous ouvre les portes d’un univers à la fois irrésistiblement attirant et quelque peu déroutant. La 3D, au premier abord de trop, s’impose petit à petit comme indispensable à la mise en relief de ce kaléidoscope envoûtant. Elle révèle toute son utilité lors de la présentation de West et d’East Egg Village. Les amoureux du roman salueront ce passage au cours duquel on nous dépeint les deux sublimes demeures se faisant face. La caméra nous transporte d’une rive à l’autre, par delà la baie. Plus généralement, bien que l’on puisse reprocher une flexion – pourtant évitable – vers le « kitsch », la plume de Fitzgerald est magnifiée par la mise en scène. Les phases descriptives, narrées, reprennent mot pour mot les passages du roman, alliant avec subtilité l’héritage littéraire et la flamboyance de la mise en scène.
« Subtilité », c’est effectivement le terme pour qualifier les jeux de DiCaprio et de Maguire. Le premier confirme qu’il est sans doute l’un des acteurs les plus brillants de sa génération, tandis que l’autre révèle une justesse dont on le pensait dénué au vu de ses derniers rôles.
La principale difficulté résidait en effet dans la transposition du récit à la première personne. Le personnage de Nick Carraway, clef de voûte de la narration, devait être appréhendé avec finesse : Maguire ne déçoit pas. Lui, pauvre témoin tantôt sans emprise, tantôt protagoniste de premier plan, nous entraine avec lui dans les frasques de son époque et l’incroyable histoire dont il est l’observateur privilégié.
DiCaprio, quant à lui, est magnifiquement introduit dans son rôle de Gatsby. Il incarne en tout point l’identité de ce mystérieux milliardaire, oscillant avec une déconcertante facilité entre tempérance exaspérante et fragiles accès de colère. Carey Mulligan, à son côté, brille par l’invariabilité de son jeu : les fans s’en satisferont. Les autres resteront sur un goût de « trop peu ».
En définitive, tout est maitrisé : de l’esthétisme à la bande originale, en passant le renversement. On chavire du rêve à la réalité en une douce transition, pourtant mêlée de violence. On ne se formalise que très peu des largesses de l’adaptation. Et c’est bien là l’essentiel : derrière les paillettes, l’ineffable vérité.
Gatsby est un monument, une institution, une référence entre toutes de la littérature américaine du XXe siècle. Chacune de ses adaptations est un exercice délicat. La première, portée à l’écran par Jack Clayton en 1974, se voulait en totale adéquation avec l’esprit du roman de Fitzgerald. La plupart des puristes avait été comblée, faisant pourtant fi du manque de saveur général qui accompagne le déroulé sans relief de l’histoire. L’époque y est peut-être pour beaucoup. Cela dit, la pression était grande pour cette nouvelle adaptation.
Véritable tourbillon de flamboyance, le film de Luhrmann est un parti pris qui ne fait que peu de concessions à la pression de l’héritage. Dès les premiers plans, on nous ouvre les portes d’un univers à la fois irrésistiblement attirant et quelque peu déroutant. La 3D, au premier abord de trop, s’impose petit à petit comme indispensable à la mise en relief de ce kaléidoscope envoûtant. Elle révèle toute son utilité lors de la présentation de West et d’East Egg Village. Les amoureux du roman salueront ce passage au cours duquel on nous dépeint les deux sublimes demeures se faisant face. La caméra nous transporte d’une rive à l’autre, par delà la baie. Plus généralement, bien que l’on puisse reprocher une flexion – pourtant évitable – vers le « kitsch », la plume de Fitzgerald est magnifiée par la mise en scène. Les phases descriptives, narrées, reprennent mot pour mot les passages du roman, alliant avec subtilité l’héritage littéraire et la flamboyance de la mise en scène.
« Subtilité », c’est effectivement le terme pour qualifier les jeux de DiCaprio et de Maguire. Le premier confirme qu’il est sans doute l’un des acteurs les plus brillants de sa génération, tandis que l’autre révèle une justesse dont on le pensait dénué au vu de ses derniers rôles.
La principale difficulté résidait en effet dans la transposition du récit à la première personne. Le personnage de Nick Carraway, clef de voûte de la narration, devait être appréhendé avec finesse : Maguire ne déçoit pas. Lui, pauvre témoin tantôt sans emprise, tantôt protagoniste de premier plan, nous entraine avec lui dans les frasques de son époque et l’incroyable histoire dont il est l’observateur privilégié.
DiCaprio, quant à lui, est magnifiquement introduit dans son rôle de Gatsby. Il incarne en tout point l’identité de ce mystérieux milliardaire, oscillant avec une déconcertante facilité entre tempérance exaspérante et fragiles accès de colère. Carey Mulligan, à son côté, brille par l’invariabilité de son jeu : les fans s’en satisferont. Les autres resteront sur un goût de « trop peu ».
En définitive, tout est maitrisé : de l’esthétisme à la bande originale, en passant le renversement. On chavire du rêve à la réalité en une douce transition, pourtant mêlée de violence. On ne se formalise que très peu des largesses de l’adaptation. Et c’est bien là l’essentiel : derrière les paillettes, l’ineffable vérité.
Nos deux plumes sont en accord : le réalisateur nous amène un souffle new-yorkais rétro et esthétique pour nous rappeler, en ce jour de récession, que la belle époque est certe dernière nous, mais qu'il faut toujours espérer.





























